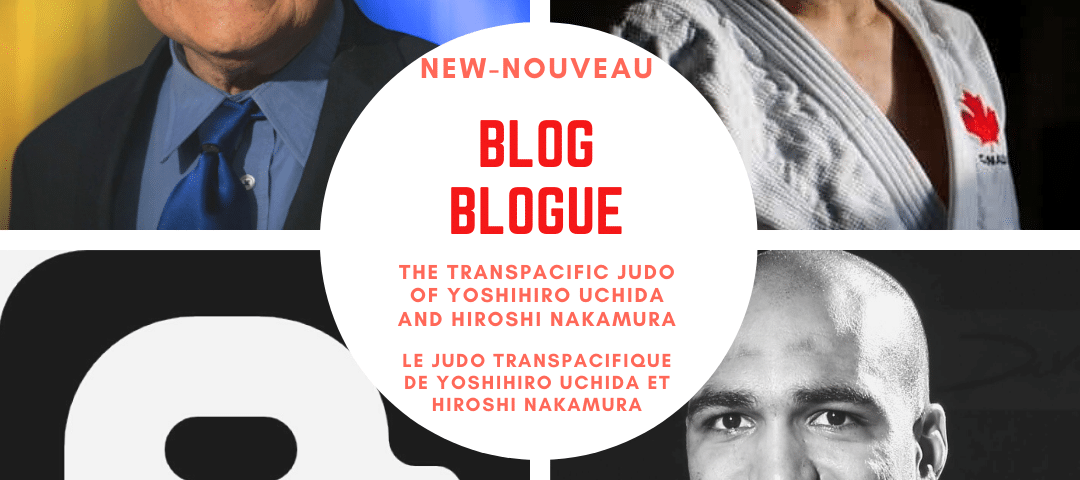Que la meilleure gagne… Tokyo!
22 April 2021
Mike Tamura siègera au comité exécutif de la fédération internationale
3 June 2021
« Pour lui, la chose la plus importante à accomplir est de terminer ses études et d’obtenir un diplôme. Devenir un contributeur-clé de la société, rendre un peu de ce que vous avez reçu. Les résultats en judo ne sont que la cerise sur le gâteau. Ils viennent après votre éducation et votre contribution à la société. »
(Keith Nakasone, élève de Yoshihiro Uchida depuis 1974)
« En tant qu’enfant ayant grandi dans le sud californien, le judo est devenu sa plus grande passion. Il a créé le système de catégories de poids avec le docteur Henry Stone de l’Université de Berkeley et cela a rendu la discipline plus équitable. Il a commencé à enseigner à la San Jose State University juste avant la guerre et, soixante-dix ans après, en est toujours le head coach. Il s’est battu pour que le judo soit aux JO de 1964 à Tokyo, a réussi et est devenu le premier entraîneur olympique du judo américain. Il a aussi ouvert le JC bouddhiste de San Jose qui accueille le plus grand tournoi des États-Unis et a donné un coup de pouce à plein d’autres clubs… Son amour de la culture japonaise se retrouve dans ses collections d’œuvres d’art et jusque dans le design de sa magnifique maison sur les collines de Saratoga. Il est fier d’être membre fondateur du Musée national des Américains d’origine japonaise, dans le Little Tokyo de Los Angeles. Pour lui, le futur c’est de ne jamais oublier le passé. »
(Jan Masuda Cougill, assistant personnel de Yoshihiro Uchida)
« La justice naît de la reconnaissance de nous-même dans l’autre. Du fait que ma liberté dépend de ta liberté aussi. Que l’histoire ne peut pas être une épée pour justifier l’injustice ni un bouclier contre le progrès, mais un manuel pour éviter de répéter les erreurs du passé. »
(Président Barack Obama, cité en épilogue de Nous étions les ennemis, roman graphique de George Takei et Harmony Becker, avec Steven Scott et Justin Eisinger, lauréat notamment du Prix Will Eisner de la meilleure bande dessinée documentaire de l’année 2020)
C’est une affaire de tectonique des plaques. De l’incidence des mouvements de l’histoire sur la géographie, la géopolitique, l’équilibre fragile des nations et l’ADN d’une discipline. Des raisons qui ont poussé des familles à l’exil, à l’aventure, à cet impératif d’écoute et d’observation qui scellent ou non une intégration, un vivre-ensemble et des identités riches de susciter un respect mutuel et constant. Solides sur leurs appuis par pedigree. Souples comme le chêne et fermes comme le roseau ou vice-versa par nécessité. Un seul « in » sépare « existence » de « inexistence », et ce préfixe change tout. Tout ici tourne autour du don, du recul et de la transmission. « La vie humaine est brève mais je voudrais vivre éternellement » écrivait le 25 novembre 1970 l’auteur japonais Yukio Mishima quelques heures avant de se faire seppuku. À l’automne d’une vie et même de deux, au terme d’une année et quelque de pandémie, et au moment où il apparaît de plus en plus clair que, pour certaines sagas familiales transcontinentales, le report et l’incertitude autour des Jeux olympiques de Tokyo 2020 puis 2021 ont quelque chose d’un supplice de Tantale intime, l’heure est au retour sur soi et sur quelques longs trajets.
Vue d’Europe, la question de la place du judo sur le continent nord-américain est rarement (p)osée. Si tel était le cas, elle pourrait être formulée ainsi : pourquoi des pays réputés de premier plan du sport mondial ont-ils produit, en proportion, si peu de judokas de renom ? Pourquoi des nations qui font quasiment cavalier seul sur des disciplines comme la boxe, le sprint, la natation, les sports de balle ou de palet, n’ont-elles accouché jusqu’ici que de si peu de grandes médailles en judogi ? Poser la question, c’est s’intéresser aux angles morts et aux silences de l’histoire du sous-continent. Dans sa frontalité comme dans ses non-dits, l’interrogation éclaire d’un jour lucide les judo canadien et états-uniens d’hier et d’aujourd’hui. Illustration en revenant sur les parcours d’Hiroshi Nakamura à Montréal et de Yoshihiro « Yosh » Uchida en Californie.
½ – Yoshihiro Uchida – Monsieur le Maire de Japantown
Le 1er avril 2020, le monde du cinéma a une pensée pour le Japonais Toshiro Mifune. Disparu en 1997, l’acteur fétiche d’Akira Kurosawa, le Kikuchiyo des Sept Samouraïs, le Tajomaru de Rashomon ou l’inspecteur Murakami de Chien enragé aurait eu cent ans ce mercredi-là. Plus discrètement, du côté cette fois de San Jose, Californie, un autre homme, bien vivant lui, entre lui aussi dans le club à trois chiffres. Yoshihiro Uchida, c’est son nom, souffle ses cent bougies en ce printemps de pandémie. Pour les proches de l’un des rares 10e dan de la planète, un moment d’émotion pure, trois ans après la disparition de Ayame Mae, sa compagne née comme lui en 1920. Covid oblige, il a fallu annuler deux semaines à l’avance la fête prévue à l’hôtel Fairmont. Sept cents invités à décommander mais qu’importe. « Nous avons tous parlé à Coach le jour de son centième anniversaire, positive Keith Nakasone, son élève depuis 1974 brillamment reconverti dans la vie civile depuis. Nous étions Mike Swain, Danny Kikuchi, Dr. Bob Nishime, Marti Malloy et moi. Il est le premier centenaire dont je célèbre l’anniversaire. C’était un honneur. Son vieillissement s’accélère rapidement et nous savons qu’il nous reste peu de temps avec lui. Mon vœu le plus cher est que le Covid-19 puisse être bientôt soigné, de sorte que Marti, les gars et moi puissions l’emmener dehors pour vraiment célébrer son anniversaire. »
D’un été avec Marti Malloy et de ce qu’il s’ensuivit… Marti Malloy, justement. C’est par la médaillée olympique 2012 et vice-championne du monde 2013 des -57 kg, que nous avons pour la première fois mis un nom sur le visage de celui qu’elle appelle affectueusement « Yosh » ou « Mr. Uchida ». D’avril à septembre 2014, nous avions suivi la Californienne pour L’Esprit du judo, le temps d’une double page dans le bimestriel français et d’une version en anglais pour le site web, intitulée « Un été avec Marti Malloy ». SMS, mails, Skype et jusqu’à un hug final au soir de son championnat du monde à Chelyabinsk (Russie), l’Américaine en profita pour raconter au lectorat français un peu de l’histoire du judo sur cette côte ouest américaine si méconnue sur l’autre rive de l’Atlantique. Originaire de l’État de Washington, elle a d’abord connu la famille Uchida par George, le petit frère de Yoshihiro, « une icône du judo par chez moi. » C’est en 2005, à son arrivée à la San Jose State University et quelques mois après le décès de George, qu’elle fit la connaissance du grand frère, déjà octogénaire. C’est lui qui fit venir du Japon Shintaro Nakano, entraîneur-clé dans la progression de l’Américaine jusqu’à sa médaille olympique de 2012, Jimmy Pedro père et fils prenant le relais sur la chaise à l’international… De son mentor au vécu incommensurable, Marti nous donna à l’époque matière à écrire ceci : « [Il] est à 94 ans toujours aussi intraitable en ne-waza, à l’automne d’une vie majuscule l’ayant par exemple conduit dès 1956 à imaginer avec un collègue de l’Université de Berkeley un système novateur de catégories de poids. Pour l’anecdote, le dojo où s’entraîne Marti porte le nom du vieux sensei. Il se trouve situé – silencieuse revanche à la nippone – dans les locaux mêmes où, pendant la Seconde guerre mondiale, les parents et les frères de Monsieur Uchida furent placés en camp d’internement… »
Cent printemps. Ce 1er avril 2020 nous vient donc l’idée de prendre des nouvelles du natif de Calexico, Californie. Marti se propose de faire l’intermédiaire et c’est peu de dire que chacune des réponses qu’elle recueille résonne déjà du poids de la postérité – mais n’en est-il pas ainsi, dans une vie de journaliste, de chaque parole par nous scrupuleusement consignée ?
Qu’est-ce que cela signifie, pour l’enfant de Garden Grove dans le comté d’Orange, de franchir ce cap des cent printemps ? « Parfois je peine à le croire car, lorsque je regarde l’ensemble des étudiants que j’ai aidés sur ce chemin, je m’aperçois que certains d’entre eux ont eux-mêmes déjà passé le cap des soixante-dix ans. Ils étaient encore des enfants lorsque j’ai commencé à travailler avec eux ! J’espère qu’ils comprendront, lorsqu’ils arriveront à quatre-vingts ans, combien il est important de rendre à la communauté judo un peu de ce qu’elle leur a apporté, et d’être reconnaissant pour les multiples façons dont le judo a impacté leur vie. J’espère surtout que, arrivés à cet âge-là, ils auront accompli quelque chose qui les rende fiers. »
Première salve. Et qu’est-ce qui le rend fier, justement, lui ? « Créer un système de catégories de poids pour aider le judo à intégrer le mouvement olympique et être reconnu en tant que sport a été le plus difficile. À l’époque, beaucoup ne mesuraient pas la chance qu’offrait ce nouveau système comparé à l’ancien. Je me suis battu pour faire comprendre que faire du judo un sport olympique le rendrait bien plus populaire aux yeux du monde. Et c’est précisément ce qu’il s’est produit. D’un art martial, le judo est devenu un sport et, ce faisant, il s’est internationalisé à l’échelle de toute la planète. En entrant dans la grande famille des sports olympiques, le judo est aussi entré dans l’esprit des gens. C’est d’autant plus important que cette discipline réunit les peuples et leur permet de mieux se comprendre mutuellement. » Deuxième salve.
Qui est l’homme qui s’exprime ainsi ? Pour nous aider dans ce travail de longue haleine, Marti Malloy nous met en contact avec le premier cercle du valeureux sensei. La première à répondre est Lydia, la deuxième des trois filles Uchida. Janice, l’aînée, n’est malheureusement déjà plus de ce monde : diplômée en arts appliqués et en ergonomie, elle eut la douleur de perdre son mari jeune et fut emportée à son tour par un cancer en 2005. Aileen, la cadette, a été diplômée de Berkeley en assistance sociale et mena une carrière universitaire à Hawaii où, avec son mari Steven Shimizu, elle consacre aujourd’hui sa retraite à la défense de la cause animale. Entre les deux, Lydia étudia pour sa part l’Environnement à l’université de Berkeley, et dispose d’une chaire en Sciences de l’éducation à l’université d’État de San José. Elle et son mari Steve Sakai ont deux garçons, aujourd’hui adultes. Kyle est ingénieur mécanique et Michael aide ses parents au restaurant ainsi que sa mère dans le soutien au grand-père. « Je prends le temps de vous lister nos différents diplômes car nous avons toutes exploré des terrains différents. Juste avant de mourir, Janice, notre aînée, a remercié notre mère de nous avoir laissées suivre notre propre route. Ma mère disait souvent que, si nous avions été des garçons, les attentes autour de nous auraient été très différentes. »
Le moment Keiko Fukuda. Toute histoire a son contexte. C’est ce que rappelle Lydia en développant son rapport au judo et celui de son père, qui noua sa première ceinture en 1930 pour « mieux connaître ses racines japonaises », obtint sa noire en 1936, disputa des compétitions scolaires de lutte et enseigna le judo à des étudiants de la police tout en menant de front des études d’ingénieur en chimie. « Bien que nous soyons allées sur à peu près toutes les compétitions de judo, nous n’avons pas eu l’occasion d’en faire, ni avec notre père ni avec aucun des professeurs que nous connaissions. Comprenons-nous bien : ce n’est pas que nous ne voulions pas pratiquer. Dans les années quarante, cinquante et soixante, il n’y avait simplement presque aucune femme judoka aux États-Unis. Il a fallu que Keiko Fukuda [Élève de Jigoro Kano, née en 1913 et disparue en 2013, elle fut la première et unique femme à atteindre le grade de dixième dan, NDLR] vienne en Californie dans les années soixante pour que l’attitude de notre père évolue sur ce point. Elle était envoyée pour étudier l’anglais à l’université de San José par son grand-père Shoichi Shimizu, un grand ami de mon père. Les femmes étaient toujours les bienvenues pour participer au cours dans notre État, mais ce n’est qu’à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix que mon père a recruté pour de bon une équipe féminine. » Une (r)évolution étalée sur plusieurs décennies, dont les fondements tiennent en deux mots : résilience et optimisme. « Nos parents étaient des enfants de migrants, rappelle Lydia. La vie n’était pas facile pour eux. Ils ont été confrontés à la discrimination et à ces mêmes périodes de difficultés extrêmes qu’expérimentent les immigrés contemporains, qu’ils soient fermiers, enseignants, étudiants ou entrepreneurs. Et pourtant, l’un comme l’autre ont été suffisamment résilients pour revenir à San Jose après la guerre afin que mon père [qui avait été enrôlé pendant quatre ans et affecté à Little Rock, Arkansas, pendant que sa famille était internée dans les camps de Poston, Arizona, et de Tule Lake, Californie, NDLR] puisse terminer ses études. Avec une femme jeune, un bébé et de maigres économies, mon père a dû cumuler trois boulots pour joindre les deux bouts. Il a fini par mettre suffisamment de côté et a pu emprunter à des médecins qui croyaient en son travail pour ouvrir son laboratoire [le premier d’une série de quarante-et-un, NDLR]. Il y a toujours cru. »
À l’école de la parole donnée. Est-ce que ce dur rapport à l’existence a fait de M. Uchida un homme au cœur de pierre ? Non. Nulle surprise en revanche de recouper les traces d’un background carré, avec la droiture en pierre angulaire de son système de valeurs. « Notre père est de la vieille école, admettent en chœur Lydia et Aileen. Il croit en la loyauté, en l’amitié, aux poignées de main et à la parole donnée. » Beaucoup plus rares sont les occasions de le voir baisser la garde, voire de se laisser aller à s’attendrir. Et pourtant… La cadette des sœurs Uchida y va de son anecdote canine : « Lorsque nous étions petites nous avions une petite chienne nommée Sandy. Mon père nous faisait remarquer avec insistance que nous ne prenions pas assez soin d’elle, qu’elle manquait d’exercice, que nous ne lui donnions pas assez le bain. Alors un dimanche il nous a prises, la chienne et moi, pour l’accompagner sur un footing sur le campus. La chienne a tenu, moi non. Elle est ainsi devenue la partenaire de ses footings dominicaux, avec douche obligatoire après pour ne pas salir la voiture. Il avait une vraie tendresse pour cette chienne. Elle, de son côté, adorait mon père. Il lui mettait même du shampooing pour bébé afin de ne pas lui brûler les yeux. » [Sourire]
Amour rugueux. Après la famille de sang, la famille de sueur. Keith Nakasone est né et a grandi à Okinawa, Japon. Il a dix-huit ans en 1974 lorsqu’il arrive à la San Jose State University, où Uchida Sensei officie depuis 1947. Titulaire pour l’équipe américaine aux JO de Moscou, il fait malheureusement partie de la génération sacrifiée de 466 athlètes qui, le 12 avril 1980, apprit la mort dans l’âme le forfait de leur pays sur fond de Guerre froide – seuls 247 seront présents quatre ans plus tard à Los Angeles. Quel souvenir garde-t-il du professeur Uchida ? « Je ne l’ai pas connu comme compétiteur lorsque je suis arrivé à San Jose car il avait déjà basculé dans l’enseignement à plein temps. S’il fallait définir son approche en deux mots, je dirais ‘Amour rugueux’. Ses bases techniques étaient solides. Pour moi, en tant qu’entraîneur, il est du même bois que les grands John Wooden de UCLA Basketball, Red Auerbach des Boston Celtics ou Vince Lombardi des Green Bay Packers. Tous étaient de grands leaders, de grands motivateurs, des férus de discipline et surtout de grands hommes ! »
« Non » n’est pas une réponse. Le challenge de cette pédagogie hors normes est rehaussé par le fait que le judo n’occupe « que » 70 % des activités du professeur, les 30 % restants concernent ses actions auprès de la communauté japonaise de San Jose. Le ratio est avancé par Jan Masuda Cougill, l’assistant personnel de M. Uchida depuis un demi-siècle et l’un des rares du premier cercle à ne pas être judoka. « Cela va des collectes de fond pour l’équipe de judo ou pour des hommes politiques à des projets comme l’installation de l’armoire pour le trophée du soixantenaire dans la salle qui porte son nom à la San Jose State University. » Une rationalisation du temps qui rejaillit sur son enseignement. À l’entraînement, Marti Malloy décrit une attention extrême portée au travail au sol et un style plutôt franc du collier au moment de débriefer d’une technique ou d’une performance. « Toute sa vie il a poussé les athlètes à être des champions sur et en dehors du tatami. Des champions qui soient utiles à la société. Lui servait comme technicien médical pour l’armée américaine lorsque sa famille a été placée en transit avant d’être envoyée dans les camps d’internement japonais, et c’est cette salle-même qui porte aujourd’hui son nom ! Il a tellement enduré, et pourtant il est resté loyal et ferme dans ses convictions, car pour lui le judo rend le monde meilleur. » Intensité, ténacité, envie de se dépasser. Cette ligne directrice vaut aussi pour les études, un sujet sur lequel, de par son parcours, il aura toujours été pointilleux. « ‘Personne ne fera le travail difficile de ta vie pour toi, donc fais-le toi-même’ a-t-il coutume de dire. Dès lors que ça concerne la réalisation de tes objectifs, ‘non’ n’est pas une réponse. Il m’a aussi dit que je pouvais ne pas plaire à tout le monde : ‘Il y aura toujours des gens pour s’opposer à tes idées. En aucun cas ces gens ne doivent t’arrêter.’ »
Judoka sur et en dehors du tapis. Mike Swain aussi connaît bien son Yoshihiro Uchida. C’est en remportant à l’âge de seize ans les trials qualificatifs pour les championnats du monde de Barcelone 1977 – finalement annulés pour des raisons liées aux relations diplomatiques tendues entre Taïwan et la République populaire de Chine – que le natif de Bridgewater, New Jersey, fut recruté par « Coach Uchida ». « Lorsque je lui ai dit que je n’avais que seize ans, il a paru surpris. Il m’a alors tendu sa carte en me disant de l’appeler sitôt que je serai diplômé. » Le -71 kg restera à la San Jose State University de 1980 à 1985. Il en sortira diplômé en Marketing avec une mineure en Japonais. Yone Yonezuka, son professeur du temps du Cranford Judo Center, NJ, fut en 1988 et 1992 l’entraîneur de l’équipe olympique et veillera toujours sur lui malgré la distance, lui permettant notamment d’aller fréquemment s’entraîner au Japon à l’Université Nihon dont il était originaire. « Coach Uchida avait déjà soixante ans lorsque je suis arrivé à SJSU donc je ne l’ai jamais vu s’entraîner. Il était à la fois un conseiller, un entraîneur et un mentor. Il s’assurait que chacun comprenne bien la portée philosophique du judo, sur et en dehors du tapis. Il supervisait le programme et faisait venir des instructeurs japonais, tous hautement qualifiés. Mais la chose la plus importante pour lui restait les études. Ça passait avant le judo, toujours. Il était particulièrement strict avec les nouveaux. Il pouvait leur demander leur moyenne générale devant tout le monde. Si ce n’était pas bon, il mettait le pauvre débutant tellement dans l’embarras que tout le monde comprenait le message, et en premier lieu l’intéressé. Idem pour voyager : costume et cravate pour tout le monde ! Nous prenions souvent le premier vol de six heures et devions donc le retrouver à quatre heures du matin à l’aéroport. » De là sans doute la constitution de l’une des équipes les plus solides de cette génération. Bobby Berland, vice-champion olympique 1984 et médaille de bronze mondial 1983, Kevin Asano, vice-champion olympique 1988, Mike Swain, en bronze aux JO 1988 et triple finaliste mondial pour un titre de champion du monde en 1987… « La force de M. Uchida était de connecter les jeunes lycéens à cet amour rugueux. Devenir meilleur sur et en dehors du tapis, tel était son credo et il ne s’embarrassait pas de manières pour vous le dire. »
Une attitude en héritage. « Beaucoup ne mesurent pas aujourd’hui l’importance qu’a eu Coach Uchida sur l’histoire du judo américain, poursuit Mike Swain. Comme le professeur Kano, il croyait fermement en la portée politique de son engagement. C’est à San Jose qu’ont eu lieu les tout premiers championnats américains, le premier US Open, les premiers championnats des lycées. Cela a demandé beaucoup d’efforts, de volontaires, d’argent et de savoir-faire. Il a été le président de USJF, de USA Judo et de USA Judo collège et se battait toujours pour ce qui pourrait aider le judo. Je lui ai rendu visite après six mois de quarantaine. Il faisait comme si de rien n’était et nous avons passé un bon moment à échanger autour du judo. Son histoire m’a ouvert les yeux sur la réalité de ce qu’ont vécu les Américains d’origine japonaise de sa génération. Le plus épatant est qu’il ne se plaint jamais de ses douleurs physiques, de ses difficultés antérieures et des discriminations que sa famille et lui ont subies, à moins que vous ne lui posiez la question. Il regarde toujours de l’avant. Il a une force intérieure et un esprit de combattant. Il s’est fait tout seul et a de quoi en être fier. Il vous donne envie de vous lever et d’essayer de faire mieux. »
« Affronte tes peurs ! ». Même son de cloche pour Bob Berland qui, trois décennies après s’être retiré de la compétition, l’appelle toujours « Mon coach ». Le Chicagoan, pur produit du Midwest, hésita longtemps entre football américain et judo. À l’époque, pour un mec de l’Illinois, SJSU était « l’ennemi », l’équipe à abattre. Aussi quelle ne fut pas sa surprise lorsque, à seize ans, il est approché à l’occasion d’un championnat des États-Unis à Chicago par Yosh lui-même. Il décline évidemment, puis affronte Mike Cochran, un élève de San Jose State University, justement. « Je le croyais gaucher et il m’a jeté en dix secondes à droite, sur sode-tsuri-komi-goshi. À ma sortie du tapis, je suis allé trouver Yosh Uchida et lui ai dit : OK, je viens. » Il lui faudra pourtant attendre de s’incliner aux trials 1980 pour comprendre qu’il ne pouvait plus cumuler foot US et judo. Il choisit le judo. À SJSU, la gentillesse de Yosh Uchida est sa première surprise. Sur le tapis, Keith Nakasone et Mike Swain représentent à eux-seuls 50 % de l’équipe olympique alors pressentie pour les JO de Los Angeles. Pour parachever le tout, le double champion du monde 1975 et 1979 Sumio Endo débarque du Japon : « Au sol, il était effrayant. »
Le sol, parlons-en. « Il m’a fait redescendre sur terre dès mon premier entraînement là-bas. Défense de taper sur les immobilisations. Soit tu t’améliores, soit tu meurs. Pour lui, la priorité était d’éliminer les points faibles. J’évitais le sol ? Alors il m’a fait bosser le sol et mon ne waza est devenu meilleur que mon tachi-waza. ‘Affronte tes peurs !’ me disait-il. Ça a été une leçon pour la vie. » Car l’expérimenté sensei a ses astuces pour maintenir ses troupes en éveil. « Il nous faisait arriver bien avant la fin du cours des débutants qui précédait le nôtre. Il nous demandait de nous laisser immobiliser par eux, et de nous dégager de l’immobilisation sans utiliser ni nos bras, ni nos jambes. Une bonne école. »
Impacter des vies. Pour lui, « il n’y a pas que le judo dans la vie car il y a avant tout de la vie dans le judo. Il nous fallait viser l’excellence à l’école, nous souvenir toujours que nous avions une carrière à bâtir en dehors du tapis. Il voulait notre succès dans les affaires. Il venait en costume au labo, tous les jours, et pouvait au besoin vous embaucher comme chauffeur pour l’y accompagner… Il ne faut jamais oublier que ses parents ont été prisonniers en Arizona pendant que lui servait pour les États-Unis. Toute sa vie, il aura bâti des ponts entre Japon et États-Unis. Le premier US Open de l’histoire, c’est à San Jose State University et nulle part ailleurs, qu’il a eu lieu. Et, pour l’occasion, il a fait venir Yasuhiro Yamashita… Son objectif a toujours été double : développer le judo aux États-Unis et impacter des vies. Quand vous impactez cent vies, vous impactez pour mille ans. »
Monsieur le maire de Japantown. « L’éducation est son autre cheval de bataille, enchaîneJan Masuda Cougill. Comme dans tout sport, une blessure peut ruiner une carrière, d’où sa vigilance sur ce sujet. San Jose est ainsi le seul centre d’entraînement olympique rattaché à une université. Cela a permis d’attirer de nombreux étudiants américains et étrangers. Vingt d’entre eux ont été olympiens et quatre ont été médaillés. Il leur dit toujours : ‘Quelle est ta moyenne générale ?’ Il faut au moins B de moyenne pour rester dans l’équipe. Il est fier de la réussite de ses adultes en dehors du judo… » Et qu’est-ce qui a le plus changé entre les années soixante et aujourd’hui ? Pour son fidèle assistant, « le principal changement est que la voix des Américains d’origine japonaise est désormais audible. Les camps d’internement ont principalement affecté la première (Issei) et deuxième (Nisei) génération. L’histoire et les injustices de la Seconde guerre mondiale n’ont été enseignées que tardivement à ces citoyens américains qui ‘semblaient différents’. La troisième génération (Sansei) a commencé à dévier de ce modèle de la minorité que nos parents nous avaient enseigné, le fameux Gaman (‘persévère et tolère avec patience et dignité’). Refuser d’être relégués à l’arrière-plan dans les années soixante et soixante-dix est devenu plus audible voire même un sujet politique sur les campus de tout le pays. Ils se sont battus pour que soient créés des cours d’études asiatiques, ont travaillé sur la réparation de l’injustice faite à nos parents et grands-parents, le fait qu’ils avaient choisi de ne pas nous transmettre notre langue et notre culture. Eux voulaient que nous soyons ‘plus américains’ après la guerre. Invisibles et impeccables. Nous, nous avons commencé à explorer des domaines que nos parents évitaient comme la politique et les arts. »
Et de poursuivre : « M. Uchida m’a toujours dit que, s’il y avait eu davantage d’hommes politiques américains d’origine japonaise pendant la Seconde guerre mondiale, les camps d’internement n’auraient peut-être pas été possibles. Je me souviens avoir lu que les politiciens italiens avaient utilisé le champion de baseball Joe DiMaggio comme exemple d’Italien loyal, et qu’ainsi cette communauté n’eut pas d’internement. Yosh a été à la manœuvre pour pousser Norman Mineta, un courtier en assurance, à s’engager en politique et à briguer le poste de maire. M. Mineta a été élu et a même poursuivi son ascension jusqu’à devenir député au Congrès et l’unique ministre démocrate de l’administration Bush en tant que secrétaire d’État aux Transports. C’est lui qui a pris la décision d’arrêter tous les avions commerciaux suite aux 11-Septembre. Pour vous dire son pouvoir ! Lui, Yosh et quelques autres Américains d’origine japonaise ont ainsi ouvert la porte à d’autres, qui ont su ensuite caler leur pied dans la porte de l’arène politique pour donner du poids aux Asiatiques. J’ai travaillé pour M. Uchida pendant de nombreuses années. Au sein de la communauté de South Bay, rares sont les candidats aux postes de maire ou de superviseur au Congrès, à l’Assemblée, au Conseil municipal ou à la Vie scolaire, qui ne nous ont pas demandé de les aider à lever des fonds. Yosh l’a fait pour un nombre infini de personnes auxquelles il croyait, avec ce titre officieux de ‘Maire de Japantown’. Tous savaient que, s’ils avaient M. Uchida avec eux, ils auraient la majorité du soutien de la communauté japonaise. »
Un chemin. Le 1er avril 2021, Yosh Uchida a soufflé sa cent-unième bougie. Un anniversaire par Zoom auquel sa fille Lydia nous invita à passer une tête au milieu du cercle des très proches. Qu’elle soit remerciée ici pour cet honneur inoubliable. Comme elle le souligne : « Pour lui, le judo a toujours été un chemin vers une meilleure compréhension entre les communautés, que ce soit à l’échelon local, national ou international. Les nombreuses amitiés durables qu’il a nouées tout au long de ces années rejaillissent sur ses élèves comme sur les autres entraîneurs jusqu’au plus haut niveau du sport international. L’important pour lui est de toujours remercier et de rendre à la communauté. Fais des choses que tu aimes ton métier et ça cessera d’être un métier. Même si au départ ce n’est pas ton rêve, tu peux retrouver des bouts de ce rêve dans ton travail. » Les principes de Seriyoku Zenyo (« efficacité maximale dans l’utilisation de l’énergie ») et de Jita Kyoei (« entraide et prospérité mutuelle ») ont ainsi toujours gouverné sa vie. « En randori comme en technique ou aux katas, vous apprenez de vos erreurs, et votre partenaire aussi, conclut-elle. Dans la vie notre père a surmonté beaucoup d’obstacles et a toujours su regarder au-delà, pour voir ce qu’il restait possible de faire. Et il a fait. »
2/2 – Hiroshi Nakamura – Comme un rayon de soleil levant
« Pour les Japonais, le deuxième conflit mondial n’est qu’une partie de la ‘Guerre de la Grande Asie orientale’, qui a commencé avec l’entrée de leurs forces en Mandchourie en 1931 » rappelle l’historien français Jean-Marie Bouissou dans Les Leçons du Japon, un pays très incorrect, passionnant exercice de symétrie comparative paru en 2019… Et pourtant. Si la date du 7 décembre 1941 et le nom de Pearl Harbour sonnent familiers aux oreilles occidentales, les répliques canadiennes de ce séisme – dont l’épicentre aux îles Hawaii aura une portée planétaire – sont moins connues côté européen de l’Atlantique. Elles constituent pourtant un chapitre douloureux mais nécessaire de Judoka – L’histoire du judo au Canada, ouvrage-somme initialement publié en 1998 par Glynn Arthur Leyshon (1929-2018) et actualisé en 2019 par Nicolas Gill, le directeur général de Judo Canada. « En février 1942 [soit deux mois après l’attaque de la base navale américaine, NDLR], le Cabinet fédéral promulgue une loi qui enclenche une période honteuse de l’histoire canadienne. Cédant à la paranoïa, le gouvernement ordonne que quelque vingt-deux mille personnes d’origine japonaise soient expulsées de leurs foyers si elles résident à l’intérieur d’une zone donnée de cent milles le long du littoral du Pacifique. Soixante-quinze pour cent des personnes visées sont des citoyens nés au Canada ou naturalisés. L’ordonnance ne sera pas abrogée avant le 31 mars 1949, alors que la guerre a pris fin en août 1945. » S’ensuivent quelques-unes de ces photos de familles peu glorieuses que chaque nation du globe est appelée un jour à devoir regarder en face et auxquelles le journaliste britannique Mark Law consacra le huitième des vingt-huit chapitres de The Pyjama Game, son érudit et exhaustif ouvrage paru en 2007. Titre de ces dix-huit pages ? « La guerre – Quand le combat dut s’arrêter ».
L’ombre portée de ces temps clivants mettra longtemps à se dissiper. Plus au sud, à Hollywood, elle constituera l’un des nombreux aspects problématiques du très puritain Code Hays qui, de 1934 à 1968, enrégimenta de manière conservatrice (euphémisme) la production cinématographique d’un pays-continent devenu superpuissance culturelle. Il faut par exemple attendre 1959 et Le Kimono pourpre de Samuel Fuller pour voir pour la première fois à l’écran une Caucasienne s’amouracher d’un Américain d’origine japonaise. C’est ce que rappellent les sœurs Clara et Julia Kuperberg dans L’Ennemi japonais à Hollywood, foisonnant documentaire paru en 2018. Au fil des cinquante-trois minutes de ce redoutable travail d’archives et de remise en perspective, les deux Françaises cochent aussi les marqueurs considérables que constituent l’arrêt Loving contre l’État de Virginie qui, en 1967, autorisa les couples mixtes puis, en 1990, la sortie de Bienvenue au Paradis du Britannique Alan Parker. Un film pionnier puisque, deux ans après avoir décortiqué la mécanique du Ku Klux Klan dans Mississipi Burning, le réalisateur britannique devient en effet le premier à montrer sur grand écran la réalité de ces camps d’internement de sinistre mémoire, ces alignements de baraquements bordés de barbelés où le décret n°9066, promulgué le 19 février 1942 par le président Franklin D. Roosevelt, parqua « à titre préventif » cent-vingt mille Américains d’origine japonaise et eut des conséquences au quotidien et sur des générations pour des milliers de concitoyens d’origine italienne ou allemande.
Qu’importe la langue. Né à Tokyo en cette fameuse année 1942, venu au judo douze ans plus tard et arrivé au Canada en 1968, l’histoire du 9e dan Hiroshi Nakamura débute là où s’achève celle de ces années de larmes, de défiance et de feu. Avant de contacter celui qui fit du Shidokan le dojo n°1 de sa patrie d’adoption – et fut entraîneur-chef pour le Canada aux JO 1976, 1988, 1996, 2000 et 2004 – pour évoquer plus d’un demi-siècle d’empreinte sur le sol unifolié, cette précaution oratoire auprès de Nicolas Gill, son élève emblématique : « Vaut-il mieux engager la conversation en français ou en anglais ? » Réponse énigmatique et pince-sans-rire du double médaillé olympique : « M. Nakamura parle aussi mal le français que l’anglais. » L’échange se fera néanmoins et il sera gorgé d’humanité. Quant à la langue utilisée, nous n’en conservons à ce jour aucun souvenir. L’essentiel était ailleurs – dans les rires, les fiertés et les silences.
Franchir un cap. Hiroshi Nakamura a vingt-deux ans lorsque les JO 1964 débutent. Le Kodokan de Tokyo où il affute son o-soto-gari – « la force de ses projections fait perdre connaissance à plus d’un adversaire », rapporte Glynn A. Leyshon dans son ouvrage précité – est déjà un passage obligé pour tout étranger qui entend franchir un cap, a fortiori en ce début de sixties où, pour la première fois, le judo est au programme des Jeux. Parmi les multiples vagues de visiteurs, le courant passe particulièrement avec les Canadiens Terry Farnsworth et Doug Rogers, venus préparer l’échéance planétaire de l’automne. Doug (1941-2020) remportera la médaille d’argent en +80 kg – « Doug, c’était quasiment un Japonais, s’amuse le sensei. Il s’est tellement entraîné sur place ! » L’invitation pour venir aider au Canada est presque une suite logique. Avant cela, en 1966, Hiroshi Nakamura effectue une tournée de quelques semaines pour enseigner en Égypte, au Soudan et en Iran, envoyé par son ministère des Affaires étrangères et le Kodokan. L’année suivante, forfait sur blessure pour les championnats du monde de Salt-Lake City, il a la surprise douce-amère de voir Eiji Maruki, son remplaçant au pied-levé, remporter le titre planétaire. Alors, en 1968, Hiroshi saute le pas : à l’Est, toute.
Prêcher par l’exemple. Son arrivée sur le continent d’en face se fait par étapes, de la côte ouest US au Québec. Peu à peu, la double barrière de la langue et des finances saute. En pleine force de l’âge, ses démonstrations en ligne deviennent sa meilleure carte de visite. Dans ce Canada où les différentes chapelles sont encore loin d’être unifiées, lorsqu’il s’agit de parler judo, il y a bientôt Hiroshi Nakamura et les autres. Le bouche-à-oreille fait le reste, malgré une vilaine blessure à la jambe en 1970 qui voit ses économies fondre et l’oblige presqu’à redémarrer de zéro. Sa détermination d’exilé et la fidélité de ses élèves du premier jour lui permettent de reprendre pied. Dédié corps et âme à la transmission de son savoir-faire, le cinquième dan devient bientôt « The place to be » à lui tout seul pour tout Canadien qui entend monter en compétence et ne plus se contenter du « l’essentiel est de participer » cher au baron Pierre de Coubertin. « Il préconisait un travail acharné, volumineux en randori et se concentrait avant tout sur la technique », se remémore Louis Jani, président du Comité de la haute performance à Judo Canada. Il fut l’élève du Maître de 1975 à 1988 au Club de judo Shidokan, avant de devenir notamment directeur technique national, directeur de la haute performance et du Centre d’entraînement national et entraîneur en chef sur l’olympiade 1997-2000. « Les autres aspects du coaching, il les laissait à d’autres. Il avait un énorme bagage technique mais, si les meilleurs judokas et les plus motivés sont allés vers lui, c’est aussi parce qu’il était peut-être le seul coach au Canada qui était disponible sept jours sur sept. C’était un coach professionnel qui prêchait par l’exemple. »
À long terme. Parmi les « les meilleurs judokas et les plus motivés » en question, il y a bien sûr Nicolas Gill, l’homme aux cinq médailles planétaires et aux cinq titres panaméricains conquis entre 1990 et 2002. Hiroshi Nakamura et lui, c’est un peu Masami Matsushita et Ezio Gamba en Italie dans les années soixante-dix. « J’avais treize ans, j’étais ceinture marron et aucun talent spécial hormis le fait que j’étais fonceur, s’amuse l’intéressé en y repensant trente-cinq ans plus tard. C’est bien simple : quand je suis arrivé, M. Nakamura a tout mis à la vidange. Le morote à genou qui m’avait jusqu’ici permis de gagner quelques médailles ? Il m’a dit de l’oublier. Il faut dire que ma poussée de croissance s’est faite sur le tard. À quinze ans je faisais encore cinquante-quatre kilos. Lui, il a regardé mon père. Il a vu qu’il était costaud et a aussitôt su le judo qu’il me fallait construire : main loin dans le dos, o-soto-gari, uchi-mata, o-uchi-gari. C’était un travail à long terme, qui a pris quatre bonnes années à porter ses fruits. La poussée de croissance sur laquelle il misait a bien eu lieu et à partir de là tout s’est enchaîné. »
Un avant et un après. Les certitudes du professeur Nakamura sont bâties sur une succession d’expériences et de paliers. Lorsqu’il est bombardé entraîneur général en 1973, les JO de Montréal sont programmés pour dans trois ans et l’équipe qui y sera alignée aura moins de vingt-deux ans de moyenne d’âge. Conscient de partir de très loin, Hiroshi Nakamura élabore un échéancier précis. L’objectif est de donner progressivement de la confiance à ses combattants. Bien sûr, la réussite de certaines individualités chez le voisin états-unien pourrait susciter des envies de rapprochement et de collaboration étroite. Mais ce serait mésestimer le facteur distance, paramètre colossal à l’échelle du sous-continent, quand bien même la renommée d’un Yosh Uchida lui est évidemment parvenue aux oreilles. « Aller de Montréal à Los Angeles ou San Jose, c’est le même nombre d’heures d’avion que d’aller de Montréal à Paris… » D’où son plan triennal : « La première année, je demandais à mes combattants de juste suivre l’entraînement. La deuxième, de venir faire randori à l’Insep en France et au Japon. La troisième, de prendre part à des compétitions dans ces pays-là. » Montréal 1976 [lien article Montréal vu de France : https://judocanada.org/fr/2013/12/29/montreal-vue-de-france/] agira alors comme un « wake-up call », l’occasion de mesurer tout ce qui sépare encore le judo du cru des meilleurs combattants de la planète et, petit à petit, de poursuivre le patient travail de structuration et d’acculturation amorcé au début de cette décennie. « Il y a définitivement eu un avant et un après Nakamura en ce qui concerne le judo de haut niveau au Canada, confirme Louis Jani. Il nous a rendu palpable ce que faisaient les meilleures nations de judo au monde. Il appréciait autant les athlètes talentueux que ceux moins doués mais qui se donnaient à fond – les ‘plombiers’ comme on dit en hockey. Pour lui, l’attitude mentale primait avant tout. Il a été très généreux envers ses athlètes, les aidant parfois financièrement, parfois en leur trouvant un sponsor ou, pour ceux qui allaient s’entraîner au Japon, en leur ouvrant des portes là-bas. Moi-même, lorsque je suis allé pour la première fois m’y entraîner, je suis resté chez ses parents. Quand des sensei japonais me demandaient qui était mon entraîneur et que je répondais Nakamura Hiroshi, ils voyaient tout de suite qui c’était. Ils disaient ‘yes, very good’ ou parfois ‘aaah… o-soto-gari’, en faisant référence à son spécial avec lequel il s’était bâti une réputation de ‘tueur’ et de technicien au Japon. C’est précisément cette réputation qui m’a facilité l’accès aux meilleurs dojos universitaires et à celui de la police de Tokyo, ainsi qu’au Kodokan. Ses accomplissements ont d’ailleurs dépassé le cadre du judo puisqu’il a été récompensé dans les deux pays, respectivement par l’ordre du Canada et celui du Soleil levant – rayons d’argent. »
Scanner mental. Dans un long entretien publié à l’été 2020 par la Fédération japonaise de judo et traduit pour Judo Canada par le septième dan Yves Landry, Hiroshi Nakamura a détaillé la sorte de scanner mental qui lui a permis, plusieurs décennies durant, de détecter presqu’à coup sûr ces générations de champions qui ont assis sa crédibilité. « Je regarde les yeux des athlètes de quatorze-quinze ans qui aiment vraiment le judo. Un enfant parle avec ses yeux. Un enfant qui aime le judo du matin au soir, qui mange du judo et rêve au judo, c’est la première condition. Ensuite, les parents. Quel support familial (moral, financier) les parents peuvent-ils apporter à l’enfant ? Contrairement au Japon, il n’y a pas de congé de frais mensuel, de logement ou de système de traitement spécial ici. Alors c’est difficile si les parents ne peuvent apporter du support. Troisièmement, jusqu’où le premier professeur a-t-il bien enseigné les bases du judo ? Il y a de terribles dojos où on ne fait pas d’ukemi. Alors, lorsqu’ils chutent, c’est difficile pour eux. C’est difficile par la suite de corriger cette situation et je suis parfois découragé avant même de débuter. Le quatrième critère c’est : jusqu’où l’athlète peut-il se rendre ? Le coach doit évaluer jusqu’où il peut se rendre comme athlète. Peut-il devenir champion canadien, panaméricain ou champion olympique ? Le reste, c’est le talent. Quatre-vingt dix pour cent du succès des athlètes ayant gagné une médaille olympique est basé sur le travail acharné et les quatre facteurs mentionnés plus le talent. Pour le reste c’est la chance dans deux ou trois pour cent des cas, ou quelque chose comme une intervention divine qui décidera pour la médaille d’or ou d’argent. Je cherche encore ce que ça peut être… »
Le sillon de la volonté. De 1976 à 2014 – année de l’ouverture du Centre national d’entraînement de Montréal – la majorité de l’équipe nationale s’entraîne sous son toit, au Club de judo de Shidokan, contribuant ainsi à faire basculer vers le Québec les forces vives d’une nation jadis mieux dotée du côté des provinces anglophones de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, proximité immédiate avec la diaspora nippone oblige. Kevin Doherty, Brad Farrow, Wayne Erdman, Rainer Fisher, Ewan Beaton, Jane Patterson ou Marie-Hélène Chisholm hier, Sasha Mehmedovic, Antoine Valois-Fortier, Louis Krieber-Gagnon ou Arthur Margelidon plus récemment sont tous d’une façon ou d’une autre passés entre ses mains. « Il a été mon coach, pas mon professeur, nuance toutefois Louis Jani, qui a débuté le judo et obtenu son premier dan à Paris avant de revenir vivre à Montréal. Pour autant, quand il enseigne le judo récréatif, il a un certain charisme et ses connaissances et son succès d’entraîneur font que ses élèves le respectent fortement. » Enseignant « à l’ancienne » doté du degré d’exigence qui va avec et d’un esprit de compétition insatiable et têtu – « aujourd’hui qu’il est moins impliqué dans le judo, c’est devenu très important pour lui de me battre au golf » sourit affectueusement Nicolas Gill -, il suit d’un œil vif et volontiers malicieux l’évolution du judo de part et d’autre de l’océan Pacifique, et laisse le soin à son élève le plus emblématique de mettre des mots sur ce qui a fondé leur succès commun et constitué peu à peu un déclic décisif pour l’ensemble du judo canadien. « Être très bien préparé physiquement, mentalement et tactiquement, résume Nicolas. À défaut d’avoir autant de partenaires que nos concurrents, nous pouvons développer les qualités qui sont entre nos deux oreilles. La volonté peut venir à bout de bien des obstacles. Ce chemin-là, M. Nakamura a commencé par l’incarner puis nous a convaincu que nous aussi, ses élèves comme les élèves de ses élèves, y avions toute notre place. C’est un sillon profond et qui vient de très loin. À nous de nous en souvenir, a fortiori lorsque, comme aujourd’hui, l’époque semble chaque jour vouloir nous tester. » – Anthony Diao